Accueil > Entente entre les peuples > Peuple-classe (99%) - peuple social (90%) - peuple d’en-bas > Une étincelle ne fait pas le printemps ! J Rigaudiat
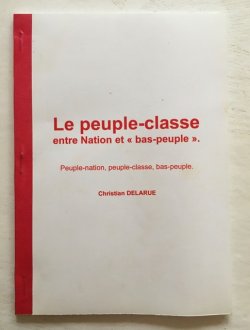 Une étincelle ne fait pas le printemps ! J Rigaudiat
Une étincelle ne fait pas le printemps ! J Rigaudiat
dimanche 12 juin 2016, par
Une étincelle ne fait pas le printemps
A propos du livre « Peuple ! », de Patrice Cohen-Séat
Jacques Rigaudiat - dimanche 29 mai 2016
Le 30 mars dernier, lors de la présentation de son livre, « Peuple ! », par Patrice Cohen-Séat (PCS) à l’invitation d’Espaces Marx j’ai été amené à en faire la critique dans une intervention orale, évidemment alors limitée par le temps. Au moment du Congrès du PCF et la situation de la gauche étant ce qu’elle est, il m’a semblé qu’il pourrait être utile à notre débat collectif de prolonger et approfondir cette discussion par une formalisation écrite de mon intervention.
Oui : ni réforme, ni révolution, bifurcation.
Avant tout, avant l’expression ferme de mes désaccords, je dois dire que la lecture du dernier opus de PCS m’a beaucoup apporté et que je partage bon nombre de ses analyses. Bon nombre, c’est-à-dire beaucoup, mais pas tout, loin de là ; on le verra dans un instant !
D’abord, dire que je partage totalement la voie politique qu’il nous propose sous le terme bienvenu et que je crois fructueux de « bifurcation » (p. 149 et suivantes). Comme l’a souligné E. Balibar dans sa présentation, c’est là un concept qui permet de mettre à distance la vieille opposition entre réforme et révolution. Une opposition à mes yeux (à nos yeux), en effet, datée. Dans une société développée du XXIe siècle, nous savons bien, quoi que certains croient ou en disent, que nous ne pouvons prétendre arriver au pouvoir les armes à la main. Nous sommes, je crois, -pour un certain nombre d’entre nous du moins-, définitivement revenus des grands soirs et, surtout, de leurs petits matins blêmes.
Mais espérer arriver au pouvoir par des voies démocratiques, ce n’est pas se résigner à n’avoir d’autre perspective que la platitude impuissante du réformisme et en être inéluctablement réduit à devoir justifier par de nobles fins des moyens douteux. « Bifurquer », cela signifie s’éloigner du « droit chemin », celui de la pente naturelle du capitalisme. C’est ne pas vouloir rompre avec tout, tout de suite, mais conduire progressivement et sélectivement des ruptures pour ne les accomplir qu’au moment où elles s’avèrent nécessaires dans une démarche d‘ensemble. Ainsi, en particulier, avec l’Union européenne telle qu’elle s’est construite, celle de la concurrence libre et non faussée (p. 125 et suivante). Faute de quoi l’éloignement n’aura été qu’un écart momentané et somme toute accidentel. Bifurquer, c’est s’éloigner avec méthode et constance. S’éloigner durablement du capitalisme par des ruptures successives, telle est donc la voie que propose PCS. Comme lui, elle est celle que je souhaite emprunter. Encore convient-il de rappeler avec quelque insistance qu’elle suppose de s’inscrire dans la perspective de l’exercice du pouvoir….
Non : l’absence d’un projet n’est pas la « véritable cause de la faiblesse des classes dominées ».
Encore faut-il pour cela parvenir à construire l’outil politique dont nous avons besoin, et dont nous savons bien qu’il nous fait aujourd’hui cruellement défaut. Et organiser la base sociale indispensable au rapport de forces, sans lequel rien, bien sûr, ne sera possible. C’est là que nous nous séparons.
Car si je salue intellectuellement l’exhumation bienvenue d’Etienne de La Boëtie et de son « Discours sur la servitude volontaire » et celle des bien oubliés AIE (appareils idéologiques d’Etat) althussériens, tout comme l’appel fait par PCS à Gramsci et à son « bloc historique » (p.97 et suivantes), je ne peux, en revanche, m’empêcher de les trouver trop bienvenus ! Certes l’analyse des formes de la domination et de l’hégémonie culturelle est indispensable, et une démarche par trop exclusivement économiste en a souvent rendus oublieux bien des marxistes. Que tout cela débouche sur la « fin du rêve » (p. 69), oui. Que tout cela amène la nécessité d’un nouveau projet, au sens le plus plein et le plus ambitieux du terme : celui d’une nouvelle « weltschauung », d’une nouvelle vision du monde, oui, cent fois oui.
Mais entre autres … Car, en revanche, je ne peux aucunement partager l’analyse univoque de PCS, qui affirme que « là est la véritable cause de la faiblesse des classes dominées, qui ne peuvent plus (…) inscrire leurs revendications dans l’horizon alternatif d’une autre société qui rendrait possible la réalisation de leurs aspirations. (…) Ce qui manque, c’est bien un nouveau projet de société autour duquel pourraient se construire un nouveau sujet historique et un nouveau bloc social » (p. 105). Pas plus que je ne peux le suivre lorsque, dans le même élan, il ajoute : « faire des divisions la cause première de la faiblesse des classes dominées revient donc en réalité à inverser l’ordre des facteurs. »
Autant le dire clairement : à mes yeux, c’est tout l’inverse. L’absence d’un projet est un effet,-l’un des effets-de la situation actuelle, l’un de ses symptômes ; et celle-ci est d’abord caractérisée par les divisions « au sein du peuple », qui en est une cause, l’une des causes. Qu’en retour, parce que tout cela dure, s’est installé et finit ainsi par se cristalliser dans un « déjà-là », la cause devienne alors aussi effet et l’effet à son tour une cause, sans aucun doute. Il n’en demeure pas moins que ce n’est que par un coup de force intellectuel que PCS peut faire advenir le projet politique comme l’unificateur, qui seul aujourd’hui manquerait.
Ce coup de force, les pages qui suivent immédiatement : « le peuple sujet historique potentiel » (p.107 et suivantes) en montrent la raison. A faire de l’analyse de la Boëtie, -celle d’une « d’une pyramide sociale qui permet au tyran d’asservir les sujets les uns par les autres » (p.97)-, la pierre de touche d’une compréhension de la société, on se voue, en effet, à enjamber, par un saut que je qualifierais de mélenchonien, l’analyse des classes sociales pour mieux atterrir dans le « peuple ». Si, comme le veut PCS, les divisions liées aux situations matérielles au sein du peuple sont secondes, si la domination idéologique est première, alors, bien sûr, seul subsiste « le clivage opposant de façon croissante deux ensembles de catégories sociales aux intérêts antagonistes : « eux », qui structurent, font fonctionner et bénéficient peu ou prou (…) d’un système fondé sur l’appropriation des moyens de production et d’échanges ; et « nous », qui en pâtissons, le subissons… » (p. 118). Bref, nous sommes 99%, ils ne sont que 1%, ce « qui exprime (…) l’idée que presque toute la société se trouverait aujourd’hui en situation de prendre conscience de ce qui l’oppose à la mince caste des dominants » (p. 118) ; voire, même si c’est exprimé avec une relative prudence, « un processus historique est manifestement en cours, peut-être en prélude à l’anticipation de Marx d’une société sans classes » (p.119).
Partir de la réalité des classes sociales et des rapports sociaux.
Ainsi, PCS a, en somme, eu,- et il faut lui en donner acte-, le mérite de mettre en ordre de façon rigoureuse et de systématiser le raisonnement implicite d’une partie de la gauche de transformation, celle qui voit dans PODEMOS, le parangon de l’analyse politique de notre temps, et pas seulement celle de l’Espagne et de son désastre social.
On se trouve alors devant une double possibilité :
Soit l’analyse, en l’occurrence subliminale, est celle d’un salariat qui, bien que devenu hégémonique reste assimilé au prolétariat. Ne demeure plus alors qu’un affrontement prolétariat/bourgeoisie. A ce moment de l’histoire, nous serions ainsi parvenus, -et c’est bien, comme on l’a vu, ce que dit PCS-, aux bords, à l’asymptote, de la société sans classes. L’unité du salariat, une unité de classe présumée donc, est première et à portée immédiate de main. Tout juste celui-ci est-il traversé par des divisions secondes, qui relèvent à titre principal de la domination idéologique. Tout l’oppose à la bourgeoisie, « mince caste des dirigeants ». Il suffit alors de déchirer le voile de l’idéologie, de dessiller les yeux des opprimés. C’est la fonction dévolue au projet, ainsi promu pièce principale de la lutte politique.
Soit il s’agit de mettre l’analyse des (luttes de) classes entre parenthèses, pour privilégier les phénomènes de domination idéologique ; c’est en somme, du moins si on le comprend bien, ce que dit PCS lorsqu’il indique qu’il emploie le mot « peuple au sens de populaire. Le mot ne peut désigner une classe unique (…), mais il permet de cerner le clivage opposant de façon croissante deux ensembles de catégories aux intérêts antagonistes » (p. 118) : « eux », les dominants, et « nous », les dominés. Le « peuple » est ainsi explicitement reconnu comme relevant d’un concept transclassiste ; ce n’est donc plus ici principalement l’appartenance de classe qui détermine l’antagonisme primordial. Mais c’est alors, mine de rien, ni plus ni moins que jeter le matérialisme historique aux poubelles de l’histoire.
Ainsi, on le voit, entre deux argumentations, a priori contradictoires et en tout cas exclusives, PCS ne tranche pas ; bien au contraire, il utilise et l’une et l’autre, même si c’est alternativement.
Face à cet argumentaire ambigu, il faut opposer deux refus.
D’abord, pour autant du moins que l’on veuille encore se situer à l’intérieur du marxisme, il faut refuser d’accorder une totale autonomie aux phénomènes de domination. Il faut donc tirer toutes les conséquences du fait que ceux-ci ne peuvent dès lors être compris que dans un cadre général, selon lequel « le facteur déterminant en dernier ressort dans l’histoire c’est la production et la reproduction de la vie immédiate » et dans une dynamique où « Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans les conditions directement données et héritées du passé » (Marx, 18 Brumaire). C’est dans les rapports sociaux de production et de reproduction de la société qu’il faut rechercher l’origine des phénomènes de fétichisme et de mystification qui légitiment les formes de la domination.
Faute de cela, en effet, on se voue à une théorisation plus ou moins paranoïde et complotiste, celle de La Boëtie en l’occurrence, pour laquelle n’existent plus qu’un tyran (et ses nervis) et des asservis. On s’adosse ainsi à une conception du sujet qui fait de la conscience et de la volonté des individus le moteur premier de l’histoire, et fait l’impasse sur les effets de structure des systèmes et la dimension de l’inconscient qu’ils conduisent à édifier. Comme l’écrivait E. Balibar il y a un quasi demi-siècle : tous les niveaux de la structure sociale « impliquent des rapports sociaux spécifiques, qui, pas plus que les rapports sociaux de production, ne sont les figures de l’intersubjectivité des agents, mais qui dépendent des fonctions du procès considéré ; en ce sens on parlera rigoureusement de rapports sociaux politiques ou de rapports sociaux idéologiques ». En ce sens, et quitte à devoir en examiner les effets réels, les « divisions » au sein du salariat ne peuvent en aucun cas être considérées comme secondes et subsidiaires.
Enfin, il faut refuser de croire sans argument à l’appui autre que prophétique, que l’hégémonie actuelle du salariat fait partie des prolégomènes à l’hypothétique parousie de la fin des classes. Face à cela, il faut affirmer que le salariat n’est pas une classe, ni en « soi », ni encore moins pour « soi ». La position de salarié emporte, certes, la commune location de la force de travail, mais n’indique rien de la place réellement occupée, ni dans les rapports de production, ni dans les autres rapports sociaux. Il faut en somme, avec Baudelot et Establet, affirmer : « Tous les salariés ne sont pas des prolétaires ».
Pour le dire très clairement : le salariat est composé de classes diverses aux intérêts a priori distincts, le prolétariat n’étant que l’une d’entre elles. Le transclassisme que véhicule la notion de peuple, comme l’universalisme ainsi implicitement revendiqué, sont alors, en retour, à comprendre, comme des formes –socialement fétichisées, et donc, individuellement, inconsciemment hypocrites- de la domination.
Au sein du « peuple » : de quelques supposées « divisions » qui sont des contradictions.
C’est de la réalité contemporaine de ces places dans les rapports, de production et sociaux, qu’il faut donc partir pour, ensuite, construire une analyse des positions idéologiques respectives de ces classes, des phénomènes de domination qu’elles emportent, comme des conséquences politiques qu’il convient d’en tirer. Il ne s’agit évidemment pas de construire ici une telle analyse dans son détail ; aussi me limiterai-je à quelques indications cursives, que je tiens pour particulièrement significatives.
Chômage des uns, quasi plein emploi des autres.
D’abord, au-delà de la diversité des places socialement occupées, de l’encadrement aux tâches d’exécution, de l’entreprise à la fonction publique, la première remarque tient au fait que, contrairement à ce que l’on n’a que trop tendance à croire, la précarité et le chômage ne sont pas le lot commun de tous les salariés. Aujourd’hui, le chômage atteint 4,4% des cadres supérieurs, 5,6% des « professions intermédiaires » ; il est en revanche de 10,1% pour les employés, et de 14,3% pour les ouvriers (et de 20% pour les ouvriers non qualifiés). Ainsi, le chômage atteint sélectivement les classes populaires, qui sont seules massivement atteintes ; les couches dites moyennes de la petite bourgeoisie salariale s’en trouvent quant à elles épargnées. Contrairement à l’Espagne, au Portugal ou à la Grèce, il n’y a pas en France de chômage de masse à proprement parler.
De surcroît et c’est déterminant, ces chiffres ne valent pas que pour aujourd’hui ; ainsi, ils n’expriment nullement les seuls effets de la crise ouverte depuis 2008. Leur remarquable stabilité relative depuis près de trente années marque au contraire clairement l’installation pérenne de réalités de vie qui sont radicalement différentes. Un chômage limité et, au-delà des cas individuels, de relativement courte durée d’un côté ; une situation durable d’instabilité et d’insécurité de masse pour les classes populaires, de l’autre. Cela d’autant plus que la précarité, qui elle s’est fortement développée au fil du temps, vient redoubler et aggraver cette réalité du chômage : 8 cadres occupés et 11 salariés des professions intermédiaires sur cent sont en situation précaire. C’est le cas de 16 employés et de 20 ouvriers sur cent.
Non, la crise, -celle durable du capitalisme depuis plus de trente années, comme son avatar paroxystique ouvert depuis 2008-, ne touche pas –et n’a, en France, jamais touché- tous les salariés d’une façon qui puisse en quoi que ce soit apparaître comme semblable. Ce ne sont ni les mêmes vies, ni les mêmes destins. Les uns ne peuvent donc en aucun cas vivre cette crise de la même manière que les autres. Il est en conséquence improbable que, collectivement, ils puissent en tirer des conséquences politiques similaires.
L’irrésistible essor de la petite bourgeoisie salariale, la stagnation et la profonde transformation des couches populaires
Cela d’autant moins que cette première réalité fondamentale de l’accès à l’emploi, qui commande les conditions concrètes de vie, est redoublée par la dynamique sociale. Dans l’espace de ces trente dernières années, en effet, la population des cadres a été multipliée par 2,5, celle des professions intermédiaires par 1,5. Dans le même temps, les ouvriers ont, au total, perdu près du quart de leurs emplois, alors que l’effectif des employé(e)s n’a progressé que de trente pour cent. Dans la durée longue du dernier demi-siècle, les évolutions sont plus spectaculaires encore : multiplication par trois des cadres supérieurs, par 2,5 des professions intermédiaires, par 2 des employés et … division par deux des ouvriers. Au total, la dynamique de la petite bourgeoisie salariale est forte ; elle s’oppose à la quasi-stagnation d’ensemble des couches populaires, qui, au demeurant, masque de profondes transformations et recompositions internes. Ce sont là des évolutions lourdes et structurelles que l’on ne peut plus continuer à superbement ignorer !
Au-delà donc des réalités de vie, qui s’inscrivent (ou non) dans le chômage et la précarité, l’imaginaire social se construit et s’étaye essentiellement sur ces dynamiques objectives de la démographie des couches sociales. D’un côté, en effet, une forte progression, qui, nécessitant une réelle mobilité sociale ascendante sur une ou deux générations, recrute largement, entre autres, parmi les enfants des couches populaires ; elle ne peut qu’être très largement intériorisée individuellement comme une réussite personnelle, qu’elle soit liée à une scolarité, ou perçue comme le résultat des efforts ou des sacrifices consentis pour construire une carrière professionnelle. De l’autre, celui des couches populaires, une transformation très profonde d’un imaginaire qui a longtemps été construit sur le mythe du travail masculin et de la qualification ouvrière. Il n’y a plus de fiers mineurs, ni de charbon ni de fer, dans notre pays et il n’est plus possible de « désespérer Billancourt » ! De surcroît, l’univers de genre des couches populaires a basculé : les hommes, qui ont globalement perdu 850 mille emplois en trente années, y sont désormais moins nombreux que les femmes (6 millions contre 6,6 millions), qui ont, elles, dans le même temps gagné 1,9 millions d’emplois.
De plus, contrairement à ce que l’on peut croire, ces réalités qui s’inscrivent dans la durée longue, n’ont pas, à ce jour, été démenties par la crise de 2008 et ses effets. Bien au contraire, elles se sont depuis lors encore amplifiées et aggravées au détriment des couches populaires. D’un côté, une forte réduction, -de l’ordre de 10% dans les trois cas-, des employés qualifiés et des ouvriers, qualifiés et non qualifiés !!! De l’autre, les effectifs de cadres supérieurs (+8%) comme de professions intermédiaires (+6%) ont, quant à eux, continué de progresser…. Plus que jamais, les dynamiques continuent à diverger.
J’y insiste. Que l’on veuille bien songer à ce que ces évolutions récentes signifient pour les catégories populaires. D’abord, parce qu’elles ont ainsi, au total, perdu quelque 900.000 emplois sur les dernières années. Enfin, en termes de difficultés à s’insérer pour les jeunes des catégories populaires… On verra que, moins que jamais, on ne peut, sans imposture, parler des jeunes, catégorie d‘âge, comme d’une seule et même couche sociale ! Qui peut ensuite s’étonner des conséquences politiques que ces réalités-là produisent ?
La « chaîne de valeur », la captation de la plus-value et la petite bourgeoisie salariée.
Si les situations et leurs évolutions s’organisent ainsi, c’est qu’elles s’originent toutes dans une seule et même cause : l’évolution du modèle productif. Je ne fais ici à titre principal référence ni à la mondialisation, ni à la financiarisation, -dont je considère qu’elles en sont des dérivées-, mais à cette transformation fondamentale,-et à mes yeux première-, du processus productif en une « chaîne de valeur ». Désormais, le « primum mobile », n’est plus la production, le chiffre d’affaires, la taille, les parts de marché ou le bénéfice d’exploitation …. Pour autant qu’il subsiste, l’acte de production est subordonné à un choix premier : celui d’une rentabilité de l’investissement supérieure au coût du capital, fonds propres inclus, la « création de valeur pour l’actionnaire ». Le taux de profit dans sa pure nudité !
Cette transformation du modèle est considérable ; les effets, économiques, sociaux, culturels et imaginaires, de l’arrivée de Vivendi et V. Bolloré au capital de Canal+ en fournissent en ce moment une assez spectaculaire illustration. Elle en induit une autre : dans le procès d’organisation, il ne s’agit plus de d’abord optimiser le procès de production, mais, en amont, d’examiner le mode optimal de segmentation de la filière qui constitue la « chaîne de valeur ». Bref, plus de tabous, ce capitalisme-là est décomplexé. Il s’agit de décider ce qui doit être produit, où et par qui, d’arbitrer entre l’internalisation et l’externalisation des différents segments de la production et entre l’intégration et la désintégration spatiales. Le résultat le plus clair en a été la fragmentation du processus de production au niveau mondial et l’éclatement corrélatif des collectifs de travail.
Ce petit détour pour en venir à ceci : dans la phase actuelle, les économies du « centre » évacuent le procès de production pour le localiser hors du territoire dans les zones à bas salaires et développent la sous-traitance pour limiter leur coût en capital. Elles développent, ou préservent, pour elles-mêmes les phases amont : la conception du produit, et aval : parfois l’assemblage final, toujours la commercialisation sous leur marque. Le reste, tout le reste en découle. Dans un pays comme la France, l’industrie ne représente plus aujourd’hui que 11,2% du PIB, son poids était de 22,3% en 1970, et le tertiaire forme désormais 77% de l’emploi total… C’est dans cette réalité-là que s’inscrivent directement les évolutions sociales que j’ai indiquées.
Cette réalité a deux autres conséquences importantes. D’abord, un tel étirement spatial et une telle fragmentation économique supposent de pouvoir remonter, -par des moyens légaux (échange inégal, prix de transfert, optimisation et évasion fiscales), ou non (fraude fiscale et sociale, recours aux paradis fiscaux, travail clandestin …)-, la plus-value vers la tête de filière. En forçant le trait pour faire image : la production est à la périphérie, les profits sont au centre… Enfin, -et c’est ce qui importe ici-, ce stade nouveau du capitalisme suppose qu’au centre la petite bourgeoisie salariée connaisse un développement sans précédent. Or, on le sait au moins depuis les travaux de Baudelot, Establet et Malemort, elle est rémunérée au-delà de la valeur de sa force de travail, selon la définition marxiste classique : sa valeur de reproduction, soit « le quantum de valeur sociale réalisé en elle ». Tout comme sa place dans les rapports de production, les conditions de vie de la petite bourgeoisie sont très clairement et à tous égards en rupture avec celles des couches populaires ; je n’y insiste pas plus ici. Elle profite des fractions de plus-value qui lui sont rétrocédées.
Résumons. Structurellement, le nouveau modèle de capitalisme requiert le développement de la petite bourgeoisie salariée, la réduction du prolétariat au centre et son développement à la périphérie. S’il suppose la remontée des profits au centre, c’est certes d’abord pour ses actionnaires, mais c’est aussi pour partiellement financer les rémunérations de cette petite bourgeoisie salariale qui lui est indispensable. Les deux vont de pair.
Ainsi, la petite bourgeoisie salariée a partie liée avec les formes contemporaines de la mondialisation et lui est globalement favorable, quand les couches populaires du centre, concurrencées par les délocalisations, y sont spontanément hostiles.
De quelques conséquences politiques.
Le salariat est divisé. La profonde différenciation entre les couches populaires et l’ensemble des couches de la petite bourgeoisie salariale, leur division de classe, voilà donc ce qu’il faut reconnaître. Tout va dans ce sens, et depuis longtemps. Ce ne sont, par conséquent, ni les mêmes représentations, ni les mêmes projets.
Des divisions sociales et de leurs effets subjectifs
Il s’en faut pourtant encore de beaucoup pour que cette seule reconnaissance suffise à comprendre la situation politique actuelle dans sa complexité. Chacun de ces deux grands blocs sociaux est, en effet, lui-même fissuré en interne du fait de deux ensembles de raisons : le premier tient à des réalités objectives, le second à leurs conséquences subjectives.
S’agissant tout d’abord de la petite bourgeoisie salariale, une première différentiation objective doit évidemment être faite entre les salariés du public (1/3 des cadres supérieurs, 45% des professions intermédiaires) et ceux du privé, qui correspond aux places différentes occupées dans le procès de production et de reproduction sociale. Or, cette division s’est très notablement affaiblie au fil du temps, ne serait-ce que parce que le développement du privé y a fortement amoindri la part du public, naguère encore majoritaire dans les professions intermédiaires. Ainsi, à s’en tenir à sa démographie, le triomphe de la petite bourgeoisie salariale est d‘abord celui des cadres supérieurs du privé ; pour cette raison, leur idéologie, -celle du succès individuel et de la mobilité nomade-, tend désormais à y devenir dominante.
Enfin, lieu par excellence de la mobilité sociale, entre souvenir de ses origines et remords de leur trahison, entre espoirs d’ascension et rancœur des illusions perdues, la petite bourgeoisie salariale est, par sa nature même, subjectivement déchirée par ses contradictions internes. Elle n’est pas d’un bloc.
Quant aux couches populaires, entre qualifiés et non qualifiés, les démographies sociales sont contrastées, on l’a vu. D’abord, une quasi-stagnation d’ensemble, mais avec un faible dynamisme en faveur des employés pour les qualifiés. Enfin, pour les non-qualifiés, une forte opposition entre la très forte régression ouvrière et la non moins très forte progression des employées, qui se redouble ainsi d’un net basculement de genre de l’emploi.
Entre l’éclatement de la classe, -résultat de l’effacement ouvrier et de l’affirmation majoritaire des employés, qui va de pair avec la naissance d’un néo-lumpen sur ses franges non-qualifiées-, et la nostalgie de l’hégémonie ouvrière, espérée et désormais perdue sans que rien ne soit encore venu en remplacer le projet, les couches populaires sont aujourd’hui à la recherche de leur identité. Elles sont à la fois divisées et anomiques.
C’est à la lumière de ce contexte général qu’il faut tenter de lire la situation politique actuelle, et d’abord l’évolution de la social-démocratie, expression à gauche d’une petite bourgeoisie salariale, dont on ne peut, par ailleurs, oublier qu’elle est politiquement divisée et vote dans son ensemble majoritairement à droite, conformément à ses intérêts objectifs.
La social-démocratie et sa dérive, expressions politiques de la petite bourgeoisie salariale et de son essor.
Sans prise en compte de ce contexte : l’essor de la petite bourgeoisie salariée et la recomposition qu’elle implique, on ne peut comprendre la dérive – pas seulement française, mais générale- de la social-démocratie, l’un des modes d’expression politique privilégiés de la petite bourgeoisie salariale, ni son européisme largement béat.
Cette dérive, certaines social-démocraties s’y sont franchement inscrites et installées de longue date, -Bad Gödesberg date de 1959-, d’autres plus récemment –la « troisième voie » de Tony Blair- ou, comme en France, très fraichement ; d’autres, enfin, faute de trouver une raison d’exister, ont purement et simplement disparu du paysage politique, comme en Italie. Cette dérive est donc aujourd’hui générale. En cela, elle n’est pas l’expression contingente de réalités nationales particulières, mais bien celle des effets politiques des évolutions qui touchent l’ensemble des sociétés capitalistes du centre. D’une certaine façon, on peut dire que la social-démocratie n’a plus de base sociale véritable et constitue ainsi aujourd’hui une force politique superfétatoire, destinée à un reclassement drastique.
En France, cette dérive atteint aujourd’hui avec le PS un point de non-retour ; l’ambiguïté native d’un ancrage qui se dit à gauche, tout en empruntant les moyens du néo-libéralisme le plus décomplexé, ne peut plus faire illusion. Depuis la « gauche plurielle », et a fortiori depuis « l’Union de la Gauche », quelque chose s’est rompu, qui en dit long sur les effets politiques des évolutions sociales en cours. Naguère, l’union était certes un combat, mais enfin elle pouvait s’imaginer, -et parfois même s’organiser bien que précairement-, avec le PS pris dans son ensemble. Cela n’est désormais plus possible.
Aujourd’hui, pour ce qu’il en reste, le PS est divisé ; mais, pour l’essentiel, ces divisions se laissent résumer en une opposition centrale entre ceux qui veulent aller jusqu’au bout de la dérive petite bourgeoise, et ceux qui, d’une façon ou d’une autre (Aubry, les « frondeurs »), affirment vouloir se maintenir dans l’ancrage historique du socialisme. L’éclatement du PS paraît ainsi la conséquence la plus probable à terme. Pour l’instant, toutefois, nul dirigeant n’a encore, à ce jour du moins, exprimé la moindre velléité de quitter le PS : tout au contraire, chacun a bien en tête soit d’y maintenir son pouvoir, soit l’espoir de l’y installer. C’est clairement l’une des difficultés du moment, qui a peu de chances de trouver une issue avant les échéances de 2017.
Pour la gauche de transformation, la perspective d’une coalition, l’obligation d’une alliance et la nécessité d’un projet.
Du côté de l’expression politique des couches populaires, en France, les principaux vainqueurs s’appellent l’abstention et le Front National. La gauche dite « radicale » ou de « transformation » reste quant à elle marquée par ses divisions et son incapacité à capter le mécontentement et l’impopularité des gouvernants d’hier comme d’aujourd’hui. Quelle stratégie définir pour aller vers le pouvoir et ainsi espérer organiser les évolutions de la société ? La diversité même des situations rencontrées en Europe permet de se fixer quelques repères.
Les données factuelles sont connues. En Grèce, malgré l’effondrement du PASOK, Syriza a été loin d’approcher la majorité des suffrages ; en Espagne, PODEMOS est devenu la troisième force politique ; il en a été de même au Portugal pour le Bloco de Esquerda. En dépit de la situation dramatique de ces trois pays, en dépit des politiques d’austérité qui y ont été conduites et dont les partis socialistes autochtones ont été à un titre ou à un autre responsables, nulle part la gauche de transformation n’a été en mesure de pouvoir gouverner seule. De surcroît, hormis ces pays en grave situation de crise, nulle part ailleurs de tels résultats n’ont été seulement approchés ; on connaît les difficultés de Die Linke en Allemagne et on n’insistera pas ici sur celles du Front de Gauche en France. Les présumés « 99% » ne sont, à ce jour, encore -et de loin- jamais parvenus à approcher la majorité de 50% dans les urnes...
De ces réalités politiques-là, il faut tirer les conclusions ; sauf évidemment à se persuader que la France se singularisera, du fait sans doute de son insoumission supposée native et du caractère particulier de ses institutions qui installent la présidentielle en clé de voute ; sauf aussi, comme certains, à attendre, tel Brice de Nice, que la vague révolutionnaire venue d’Amérique latine et passée par les printemps arabes atteigne nos rivages pour pouvoir, un jour, surfer dessus ….
De ces réalités, pour ma part, je tire trois conclusions :
La perspective d’une coalition de gouvernement.
Nulle part la gauche de transformation n’a été en mesure de gouverner seule. Si elle veut participer à l’exercice du pouvoir (ou à un « soutien sans participation »), elle doit intégrer la perspective d’une coalition avec d’autres forces politiques qui lui sont extérieures. Bien que témoignant de situations différentes, les exemples du Portugal, de l’Espagne et à, un autre titre, de la Grèce sont là pour le montrer : quoi qu’on en ait, la question des rapports avec les socialistes ne peut alors être évacuée.
L’obligation d’une alliance de classes programmatique.
Dans le grand reclassement et la recomposition des forces sociales qui caractérisent notre période, les couches populaires ne peuvent ni lutter seules, ni s’efforcer, comme hier, de réunir autour du projet propre à la seule classe ouvrière. Il faut une alliance de classes et il faut lui donner une expression politique propre. Force est de constater, à cet égard, qu’aucune des forces de transformation qui comptent en Europe n’a de base, ni sociale, ni partidaire, unique. Au surplus, -et le cas de l’Espagne est topique à cet égard-, compte tenu de sa dérive, il est inenvisageable de discuter avec la social-démocratie d’une éventuelle coalition sans être en mesure d’être dans un rapport de forces favorable. Celui-ci doit permettre, d’une part, d’imposer un programme de réelle « bifurcation » et, d’autre part, de donner un minimum d’assurance quant à sa réalisation effective. Trois conditions doivent pour cela être réunies :
Toutes ces forces de transformation sociale sont des coalitions de partis, qui elles-mêmes conduisent à recomposer le paysage politique en adéquation avec le nouveau paysage social. Ces coalitions expriment une alliance de classes.
Un compromis à vocation majoritaire doit ainsi être passé entre les aspirations politiques des couches populaires et celles de la petite bourgeoisie salariale, du moins avec celles de ses franges militantes, écologistes ou ex-socialistes détachées de la social-démocratie, qui veulent la transformation sociale.
La perspective commune est celle d’une participation à l’exercice du pouvoir, possiblement de coalition, ce qui doit conduire à exclure les forces « révolutionnaires » ou « radicales » qui s’y refusent.
– La nécessité d’un projet de transformation et de « bifurcation »
Enfin, il est, bien sûr, nécessaire de définir clairement les voies de la transformation et leurs étapes. De le faire à la lumière de l’espoir à ouvrir pour les classes populaires et des attentes de leurs alliés. Mais il n’y a là, me semble-t-il, pas de véritable divergence entre PCS et moi.
***
« Le peuple, la souveraineté populaire, la volonté générale, la société, le commun, …. ça n’existe pas ». C’est pourquoi rien de tout cela ne peut préexister au processus de construction imaginaire qui en édifie les concepts. Encore faut-il que ce processus s’étaye de la réalité qui le fonde : celles des classes sociales, de leurs intérêts et de leurs besoins.
Dans le moment de profonde recomposition sociale qui agite notre société depuis quelques décennies sous l’empire d’une transformation économique d’ampleur, ces catégories n’ont plus de réalité. Ou, plus exactement, cet imaginaire-là est au sens propre devenu sans fondement, une pure abstraction métaphysique. C’est pourquoi ceux qui s’y réfèrent sans précaution sont « ceux qui pensent leurs intérêts particuliers comme universels ». Bref, c’est l’affirmation par la petite bourgeoisie de sa volonté d’hégémonie idéologique. Les croire, c’est y céder.
L’unité, nécessairement partielle mais à vocation politiquement majoritaire, du salariat ne peut pas être un présupposé. C’est une alliance de classes qu’il faut construire, en dépit des intérêts différents des couches sociales appelées à la composer, et dont il faut préalablement dessiner les contours pour, ensuite, parvenir à en imposer la volonté. Pour cela, il faut aussi, bien sûr, en dessiner le projet, mais ce n’en est là que l’un des aspects : nécessaire mais pas suffisant.
C’est ainsi dans le rapport des couches populaires à la petite bourgeoisie salariale que les contours de cette alliance peuvent être définis. Il y a des conditions politiques à une mise en œuvre de la transformation sociale : il faut bien alors parler alliances, compromis et accord de programme pour en construire l’expression politique unifiée. Mais il faut d’abord dire avec qui et pourquoi.
Pour cela, il ne suffit pas, comme le veut une récente pétition, de « Rallumer l’étincelle du Front de Gauche ». Il faudra aller bien au-delà. Une étincelle, fut-elle celle du Front de Gauche, ne fait pas le printemps.
–
 Amitié entre les peuples
Amitié entre les peuples